À première vue, le titre de ce billet paraît manquer de pertinence : un livre d’histoire, c’est un livre qui parle de faits historiques, point final. Quel serait le besoin d’aller plus loin ? En fait, il n’est pas si simple au lecteur de s’y retrouver dans la jungle d’ouvrages traitant plus ou moins du passé. Sont-ils tous identiques tant sur le fond que la forme ? De l’immuable « Que sais-je ? » des PUF au « beau livre » illustré, en passant par la thèse remaniée d’un jeune docteur ou le jet rageur d’un essayiste tordant Clio pour faire avancer son agenda politique, il y a une foule de titres, de collections, d’éditeurs, de types de livre, d’erreurs à éviter. Il ne s’agira pas là de passer en revue de manière exhaustive tout ce qui peut exister, mais de donner quelques éléments constitutifs de ce qu’un historien de métier peut considérer comme un livre sérieux et digne de confiance. Je procéderai par grands points.
1° Histoire et fiction
Tout d’abord, un livre d’histoire est un ouvrage qui reprend la méthode scientifique historique. C’est-à-dire qu’il essaie de donner un récit explicatif de faits qui se sont produits dans le passé, en suivant un plan précis, en définissant les termes de son sujet, en critiquant les sources utilisées. Ce n’est donc pas un roman qui invente des personnages, ou prête des dialogues imaginaires à des figures ayant réellement existé. Il ne s’agit pas d’opposer les deux (j’aime moi-même beaucoup les romans historiques) mais seulement de rappeler que la forme, le fond et la finalité sont différents.
Ainsi Survivre. Une histoire des guerres de Religion de Jérémy Foa est un livre d’histoire sur cette question. Il va mobiliser des sources, les critiquer, les relier à une bibliographie existante et produire un récit le plus fidèle et neutre possible du passé. En revanche, sur la même époque, Fortune de France de Robert Merle est un roman. Fouillé, bien écrit, plaisant à lire, mais ce n’est pas la même chose. L’auteur invente des personnages (les Siorac) au service d’un récit, pour divertir son lecteur. Un livre d’histoire va bel et bien raconter une histoire lui aussi, mais c’est un « roman vrai » pour reprendre une expression de Paul Veyne dans Comment on écrit l’histoire.
2° Historien(e) : un métier
Ce qui vient d’être dit est lié au statut de l’auteur. Si l’histoire appartient heureusement à tout le monde, l’établissement de son récit scientifique est un métier, qui se découvre au cours de longues études. Elles durent au moins huit ans et on y apprend l’art de critiquer les documents, de s’orienter dans les archives, revues et livres scientifiques, de construire un sujet d’étude et de parvenir au bout de l’enquête (c’est le sens du mot histoire en grec). Ces années d’apprentissage se terminent généralement par un doctorat sur un sujet encore inédit. Celui-ci est accepté et validé par ses pairs à l’issue d’une soutenance publique et généralement publié. Par la suite, jusqu’à la fin de sa carrière, chaque récit écrit par un historien est critiqué, corrigé, nuancé, accepté par des comités de lecture constitués de membre de la profession.
Être historien ne s’improvise donc pas. Or, beaucoup de livres traitant de sujets historiques ne sont pas écrits par des professionnels de cette discipline. Cela est permis par le fait que l’histoire, comme je le disais, appartient à tous et que « science molle » (on dirait plutôt science humaine dans le métier), elle apparaît comme plus simple que la physique quantique. Ainsi, des hommes et femmes politiques s’y risquent, comme des journalistes, des essayistes et autres polémistes. Ils cherchent généralement dans le passé des éléments susceptibles de faire avancer leurs combats. Toutefois, bien des auteurs peu familiarisés avec les méthodes et l’éthique du métier se trompent allègrement : en recopiant des documents d’archives sans les critiquer (alors que beaucoup de leurs producteurs mentent, enjolivent, oublient, falsifient les faits), en reprenant des travaux de faussaires, en propageant des mensonges, des idées reçues, en omettant de parler de ce qui les gène (violences en tout genre, points de vue contraire aux leurs…) pour mieux servir leurs propos.
Mon conseil serait donc de bien vérifier qui est l’auteur du livre que vous envisagez de lire. S’il n’a pas fait d’études d’histoire, à part quelques exceptions qui confirment la règle, mieux vaudrait passer son chemin.
3° Administrer la preuve
De plus, beaucoup de ces livres ne justifient rien de ce qui est écrit : il faudrait croire leurs auteurs sur parole. Or, un professionnel de l’histoire administre la preuve de ce qu’il avance, selon la formule consacrée. C’est-à-dire qu’il donne ses sources au fil de notes, indique les livres qu’il a lus, s’il est d’accord ou non avec l’interprétation des collègues cités et, si oui ou non, pourquoi et de manière argumentée. Il s’agit en premier lieu d’une honnêteté intellectuelle et en second lieu de permettre à toute personne intéressée de consulter les ouvrages et archives, pour poursuivre le travail engagé, le débat, ou par simple plaisir de lecture.
L’appareil critique (notes, bibliographie, index…) peut légitimement effrayer, car il occupe un certain volume et paraît au lecteur pressé « inutile », voire encombrant. D’ailleurs, certains éditeurs le rabattent en fin de chapitre, de volume ou l’allègent. Il reste toutefois fondamental pour justifier ses choix, suivre la pensée d’un auteur et aller plus loin. S’y habituer progressivement et l’apprivoiser n’est pas une mince affaire, mais constitue ensuite une clé de lecture fondamentale pour comprendre l’histoire. Un livre qui n’a pas d’appareil critique ou de table des matières solide qui permet de voir comment l’historien(n)e défend son point de vue sera généralement suspect.
4° Forme et fond variés
Toutefois, les livres d’histoire restent de forme et de fond variés et il est important de connaître les principaux types d’ouvrages. On les distinguera selon le type de public visé : universitaire ou non. Les premiers sont souvent considérés comme les plus ardus, les moins faciles d’accès, tant sur le fond (le sujet traité est très précis), que la forme (le langage est plus scientifique). C’est souvent le cas, mais cela n’a rien que de très normal, car ils sont avant tout destinés à la profession et aux étudiants. Il ne faut donc pas s’en étonner. Ce sont principalement des Actes de colloque, des thèses, des ouvrages collectifs sur un sujet précis, issus de projets de recherche. Le tirage est limité (souvent quelques centaines d’exemplaires), la diffusion plus restreinte qu’une énième biographie de Louis XIV et le but est principalement scientifique. Un lecteur intéressé devrait pourtant se risquer à la fréquentation de tels ouvrages, souvent disponibles en ligne sur le site de l’éditeur et dans de nombreuses bibliothèques. Ils traitent de manière fouillée d’un sujet, ce que ne permet pas une synthèse de 300 pages sur un siècle ou une époque. Au final, ils nourrissent la vulgarisation, les manuels scolaires, les expositions, la presse.
La majeure partie de la production, en termes de tirage, reste pourtant les livres qu’on trouve dans les plus grandes enseignes de distribution. Ce sont des livres de synthèse sur une époque (La collection Histoire de France chez Belin), un pays (Histoire de l’Angleterre de Philippe Chassaigne) ou des biographies de grands personnages parues chez Fayard ou Perrin. Le public visé est plus large, les tirages sont plus grands, l’appareil critique est généralement moins présent. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas d’intérêt, au contraire. Ces livres constituent une part importante de la mission de vulgarisateur de l’historien, qui doit rendre ses connaissances accessibles au plus grand nombre. Un lecteur intéressé doit pouvoir trouver un travail sérieux et plaisant à lire sur les totalitarismes, la Renaissance, sur Lénine ou sur l’histoire des Pays-Bas. De plus, ces ouvrages sont aussi lus par les historiens de métier qui s’en servent pour leurs bases de cours, pour orienter les étudiants et pour le simple plaisir d’apprendre. On regrettera toutefois que certains sujets pourtant importants soient moins traités que d’autres, pour des questions d’intérêt et de commercialisation. Il est ainsi bien plus facile de trouver des livres grand public sur la Seconde Guerre Mondiale que sur la Restauration ou l’histoire religieuse du XVIIIe siècle (cela ne veut pas dire qu’il n’y a rien !).
Il y a également de nombreuses exceptions, de nombreuses nuances à apporter à ce qui a été dit : certaines biographies ne sont pas dans des collections de grands éditeurs et sont tirées de thèses (Waldeck-Rousseau de Pierre Sorlin…), certains livres « grand public » ne sont pas faciles à lire. Il existe aussi des livres très précis que je n’ai pas cités comme des manuels de concours pour préparer l’agrégation ou le CAPES. À chacun de découvrir les types de livres, les collections et auteurs qui lui plaisent avec le temps et au fil des lectures, sans pour autant négliger totalement les autres.
5° De l’obsolescence programmée en histoire
Un livre d’histoire est plus ou moins rapidement condamné à l’obsolescence. Il sert surtout à donner l’état de l’art à sur une question à un moment donné. D’ailleurs, lorsqu’il sort, il a été mis en écriture et production quelques années auparavant et la recherche a déjà progressé entre temps… En un sens, il est déjà « caduc ». De plus, il peut susciter l’envie de nouvelles recherches (par soi ou d’autres) qui vont l’amender, le préciser, le dépasser… C’est tout le mal qu’on lui souhaite.
Ce processus de vieillissement dépend bien sûr de l’objet traité : on écrit plus sur Napoléon que sur le commerce du bois dans l’Antiquité grecque. Un livre revenant sur un sujet de niche peut bénéficier d’une certaine autorité plus longtemps. D’autres, hors-normes par le style, le sujet traité et/ou l’ampleur de l’auteur deviennent des classiques « indémodables » qui continuent à faire autorité. Je citerai Les rois thaumaturges de Marc Bloch ou La Méditerranée et le monde méditerranéen au temps de Philippe II de Fernand Braudel, qui continuent de « traumatiser » des générations d’étudiants.
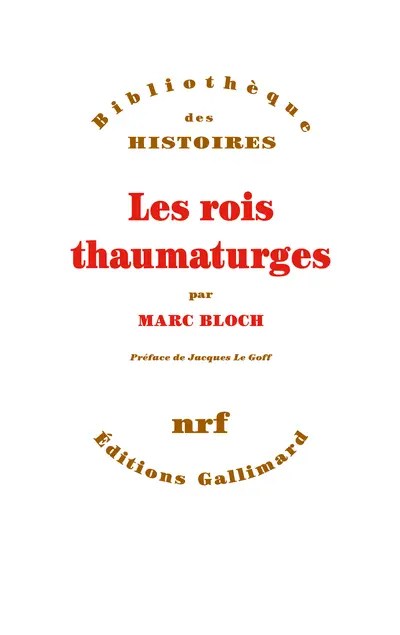
Finalement, au bout de quelques décennies, un livre d’histoire devient à son tour une source ! La communauté scientifique le lit moins pour son contenu que pour la façon dont il est délivré. Il permet de voir comment on écrivait l’histoire à une période donnée et renseigne sur une discipline en fait très actuelle : on interroge toujours le passé avec des questions du présent. Il n’y avait par exemple pas autant, voire pas, de livres sur l’histoire environnementale avant que cela ne devienne un enjeu contemporain (années 1970-1980).
Le lecteur ne devrait donc pas considérer que le livre qu’il vient de lire sur la guerre de trente ans est définitif. Dans X années, il pourra en lire un autre qui montrera l’avancée de la recherche sur le sujet et constater ce qui aura changé. Certains auteurs mettent d’ailleurs eux-mêmes à jour leurs livres qui bénéficient de plusieurs éditions au cours de leur carrière. Ainsi, le grand classique Naissance et affirmation de la Réforme a connu une dizaine d’éditions. Il serait intéressant de comparer la première et la dernière…. J’ajouterai qu’il est aussi toujours bon de relire sur un sujet, même si on le connaît, et d’aller voir des auteurs de différentes nationalités sur la question.
6° Des limites à ce qui a été dit
En guise de conclusion, je rappellerai que tout ce qui a été dit plus haut mérite d’être nuancé. Il s’agit plus d’un petit guide et chaque point mériterait un article à lui seul. La critique des sources, la neutralité et la subjectivité de l’historien ont par exemple fait couler beaucoup d’encre et doivent être interrogées, ce qui sera fait ici en temps et en heure.
De plus, malgré la prudence, on peut toujours commettre des erreurs : certains éditeurs publient des journalistes, essayistes et autres chroniqueurs qui se vendent bien, tout simplement par nécessité économique. Le fait qu’ils soient mis sur le même plan que les historiens contribue toutefois, à mon avis, à brouiller les pistes et entretenir l’idée que n’importe qui peut écrire de l’histoire.
D’ailleurs, il arrive que des historiens eux-mêmes écrivent des livres de commande plus éloignés de leurs spécialités que d’autres, et souvent moins pertinents. D’autres, heureusement rares, sortent de leur réserve scientifique sans le dire clairement, pour faire avancer des idées politiques, religieuses, culturelles. Quelques-uns même versent dans le négationnisme : n’oublions pas que Robert Faurisson était à l’origine maître de conférences en littérature, certes pas en histoire, mais universitaire quand même. Il s’agit évidemment d’un exemple extrême.
Un moyen de se prémunir de tout ceci est bien sûr de lire des recensions critiques sérieuses des ouvrages, d’en parler à ses proches et de se faire conseiller par un bibliothécaire, un enseignant.
Bibliographie indicative
- Bloch Marc, Apologie pour l’histoire ou métier d’historien, Paris, Dunod, 2024, 264 p.
- Veyne Paul, Comment on écrit l’histoire, Paris, Points, 1996, 438 p.
- Prost Antoine, Douze leçons sur l’histoire, Paris, Seuil, Points, 2014, 384 p.
- Thuillier Guy et Tulard Jean, Le métier d’historien, Paris, PUF, coll. « Que sais-je » ?, 1995, 127 p.

